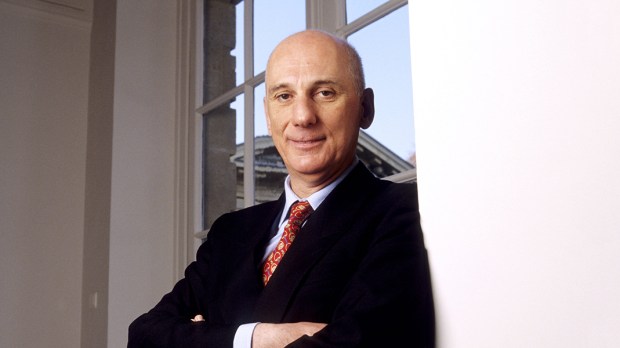Déjà secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et belles-lettres, le médiéviste Michel Zink a été élu, en décembre dernier, à l’Académie française au fauteuil de René Girard. La renommée de ce professeur, spécialiste de littérature du Moyen Âge, réputé pour sa compréhension très fine de la sensibilité médiévale, est internationale. Pour toutes ces raisons, Aleteia est allé rencontrer ce grand connaisseur de la vie religieuse du monde médiévale.
Aleteia : Vous évoquez dans vos derniers livres la place ambivalente de l’humiliation au Moyen Âge en la confrontant avec ce que nous sommes aujourd’hui dans un titre éloquent L’humiliation, le Moyen Âge et nous. Ma première question portera essentiellement sur cet “et nous”. En quoi le Moyen Âge peut-il nous éclairer aujourd’hui ?
Michel Zink : D’une façon générale, le Moyen Âge a beaucoup de choses à nous apprendre sur nous-mêmes car il est notre passé. Evidemment, toute époque passée est notre passé, comme l’Antiquité classique. Mais le Moyen Âge est notre passé pratiquement sans rupture de continuité. Par exemple, dans le cas précisément de l’humiliation, le Moyen Âge est important pour nous car il est la première époque chrétienne, l’époque où le christianisme s’est répandu en Europe. Je suis persuadé que notre représentation de l’humiliation, le lien que nous faisons entre l’humiliation et l’humilité, et le fait que l’humilité soit pour nous une valeur positive, tout cela nous vient du christianisme, même pour ceux qui aujourd’hui l’ont oublié. Quelque chose de très simple le montre : dans l’Antiquité classique, païenne, le mot “humble” n’a jamais de sens positif. En latin, le mot humilis vient de humus, “la terre” et veut dire “à ras de terre”. En grec, c’est le même sens toujours négatif. La valorisation de l’humiliation n’existe pas. Au contraire, il faut se faire valoir, accomplir son destin, être glorieux. Pour l’ensemble des civilisations du monde, être humilié, être mis plus bas que terre, est quelque chose d’insupportable.
La valorisation de l’humilité est chrétienne pour une raison très simple : pour un chrétien, Dieu s’est incarné, il s’est fait homme. Il a renoncé à la supériorité d’être Dieu pour n’être plus qu’un homme, vulnérable et mortel. Dieu lui-même vit un abaissement. On le voit dans un passage célèbre de l’Épître aux Philippiens, chapitre 2 : “Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix”. C’est tout l’enseignement de saint Paul, la suprême supériorité se trouve dans l’abaissement et l’inférieur n’est pas moins digne que le supérieur, au contraire. C’est le paradoxe même du christianisme.

Lire aussi :
L’humiliation, le Moyen Âge et nous
Dans le contexte actuel de la déchristianisation, le fait de prendre le parti de l’humilié pourrait s’amoindrir. Dans vos ouvrages, vous évoquez quelques auteurs qui sont allés contre le christianisme pour refuser cette valorisation de l’humilité, notamment Nietzsche et Schopenhauer.
Effectivement, il y a un moment où la pensée moderne s’est révoltée contre cette recherche de l’abaissement. On a vu dans l’humilité chrétienne une sorte d’hypocrisie ou de faiblesse. Mais il est d’autant plus frappant de voir aujourd’hui qu’une société qui a tellement été marqué par ces auteurs, qui recherche essentiellement l’épanouissement personnel et non l’oubli de soi comme pouvait le faire l’ascèse chrétienne au Moyen Âge, une société loin des valeurs chrétiennes donc, continue à prendre le parti de l’humilié. C’est là que je vois une subsistance cachée, inavouée de cette pensée chrétienne née au Moyen Âge.
Vous mettez par ailleurs souvent en lumière cette contradiction entre les valeurs de la société et celles de la religion : entre une Église trop intégrée à la société pour ne pas en jouer le jeu mais trop imprégnée de sa foi pour ne pas en mesurer la contradiction entre les deux ordres de valeurs.
On le voit très bien au Moyen Âge. D’un côté, très naturellement, on veut que la foi chrétienne triomphe, on trouve naturel que l’Église triomphe et soit puissante pour qu’elle puisse défendre le Christ. Mais en même temps, on est gêné dans cette puissance de l’Église qui se manifeste par cette richesse et cet orgueil. On sait bien qu’il faut rechercher la pauvreté évangélique.
L’histoire des ordres monastiques le montre particulièrement. Les moines doivent pratiquer la pauvreté, l’obéissance et la chasteté dans une vie humble et simple. Mais voilà que l’ordre bénédictin devient infiniment riche et puissant. On voit apparaître, au moment où cette puissance éclate à la fin du XIe siècle – c’est le moment de la réforme grégorienne –, toutes sortes de réformes monastiques pour revenir à la pauvreté monastique : saint Norbert et l’Ordre de Prémontré, saint Bruno et les Chartreux, saint Bernard de Clairvaux et l’ordre de Cîteaux. Chaque fois est imposée une règle de plus en plus sévère, à mesure que l’ordre s’enrichit. Et chaque fois, il faut recommencer, jusqu’à une réforme plus radicale au début du XIIIe avec les franciscains et les dominicains notamment avec les ordres mendiants. Ces ordres réalisent qu’il ne faut pas seulement que le moine soit pauvre, mais aussi l’ordre. On voit ce mouvement d’aspiration constante à la pauvreté au sein d’une Église qui, elle, est puissante. C’est la contradiction que je note. Car ce qui est important, et qui change cette vision de la puissance, c’est la mauvaise conscience. On se dit : “Il ne faut pas oublier l’enseignement du Christ, la pauvreté, l’humilité, la nécessité de se pencher sur le sort des hommes qui souffrent”. Tout au long du Moyen Âge, tout ceci n’est jamais oublié.


Lire aussi :
Top 5 des choses méconnues sur la mode au Moyen Âge
Parmi les médiévistes, vous êtes un professeur de littérature. Que vous a apporté dans vos recherches cette approche du Moyen Âge par la littérature ?
Le terme de “médiéviste” désigne celui qui étudie le Moyen Âge. Il peut être un historien, un philologue, un philosophe, un littéraire, etc. Énormément de médiévistes ont, comme moi, une formation par les lettres classiques. J’aborde le monde médiéval non seulement par l’étude des textes littéraires, mais aussi par une réflexion sur ce qu’était la littérature à l’époque et par un va-et-vient constant entre la littérature médiévale et la littérature moderne et contemporaine.
On pourrait considérer que pour connaître une époque du passé, il est plus sûr d’étudier des documents historiques et les monuments qui donnent des indications précises sur les faits. La littérature, à l’inverse, relève de la fiction. Ce n’est pas la réalité des faits qu’elle permet d’atteindre. Pourtant, rien autant que la littérature ne permet, si on l’étudie avec rigueur et précision, de comprendre les formes de pensée, les sensibilités. Elle permet de comprendre ces événements que l’on reconstitue par l’histoire mais qui ne prennent leur sens que si on sait ce que ceux de cette époque ressentaient, comment ils vivaient les choses, comment ils réagissaient devant la beauté d’une femme, d’un paysage, d’un monument, devant la misère du monde ou devant la mort. Si l’on sait le comprendre, un poème ou le commentaire d’un poème, les chroniques de cette époque, même si elles se trompent, sont extrêmement enrichissantes. Cela vaut aussi pour aujourd’hui, pour notre époque et sa littérature, et pour d’autres pays.
À une époque, j’allais très souvent au Japon. Si ma connaissance du Japon avait reposé uniquement sur l’histoire, sur des traités d’économie et de politique, j’aurais vu le Japon comme un pays effrayant : le Japon des violences et crimes de guerre pendant la seconde guerre mondiale, le Japon du travail à outrance. Mais j’avais lu beaucoup de littérature japonaise et je connaissais bien le cinéma japonais. Ils m’ont donné une vision du Japon très différente : celle de d’une très subtile délicatesse, une extrême discrétion et une grande attention aux autres. C’est ce qui m’a aidé à ne pas être trop dépaysé et à me faire vite des amis japonais.
Cela vaut aussi bien pour la connaissance du passé. C’est pour cela que la littérature est si précieuse. Elle l’est aussi s’agissant d’une langue qui est la nôtre : on peut faire un va-et-vient entre nous-mêmes, les textes d’aujourd’hui et ce qui s’écrivait et se pensait à l’époque. Cela nous arrache à nous-mêmes, tout en nous permettant de nous regarder et de mieux nous comprendre.

Lire aussi :
Comment remonter le temps jusqu’au Moyen Âge sans quitter Paris ?
En parlant de littérature, dans votre ouvrageBienvenue au Moyen Âge, vous évoquez l’ouvrage de Chrétien de Troyes, Érec et Enide qui parle de l’amour conjugal et met en avant un mariage d’amour. Alors qu’on prétend voir la naissance du mariage d’amour au début du XIXe siècle, il semble que Chrétien de Troyes en 1160 le voyait déjà comme un idéal.
C’est ce qu’on appelle l’amour courtois, dont on dit souvent qu’il est systématiquement adultère. C’est vrai qu’il l’est souvent, mais Chrétien de Troyes, qui est un moraliste, essaie de montrer ce que peut être un amour passionné dans le cadre de l’amour conjugal. L’Église encourageait déjà le mariage d’amour et en réalité elle a toujours encouragé le mariage d’amour. Par conviction, elle considérait que les époux devaient se choisir et s’aimer. Chrétien de Troyes, dans au moins deux de ses romans, réfléchit sur ce qu’est l’engagement conjugal : il est bien beau de se marier parce qu’on est amoureux, mais il faut aussi concilier ses devoirs d’État avec ceux que l’on a envers son conjoint.
Une œuvre de la même époque est tout aussi passionnante. C’est une chanson de geste de Girart de Roussillon, dans laquelle le héros ne peut pas épouser la femme qu’il aime et qui l’aime car le roi exige de la prendre pour épouse. Il est alors contraint d’épouser la sœur de cette femme. Tout en restant fidèle à ce premier amour leur vie, aimant chastement l’épouse du roi, il apprend à aimer celle qu’il a épousée. Celle-ci l’a converti et lui communique sa sainteté. C’est une histoire magnifique.

Et qu’en est-il des rapports entre littérature et religion. On a pris l’habitude depuis le XIXe siècle de voir une forme de concurrence entre le prêtre et le poète, ce dernier étant tenté d’éclairer les âmes à la place du prêtre. Qu’en était-il des rapports entre prêtres et poètes au Moyen Âge ?
Les troubadours sont les poètes de langue d’oc qui écrivent des poèmes d’amour. D’origine anglaise, ils se sont répandus dans toute l’Europe. Ils chantent un amour profane qui n’est pas un amour chaste. C’est souvent un amour adultère. Ils ne sont donc pas du tout dans la ligne de la morale chrétienne mais, dès les premiers d’entre eux, il y a un effort pour situer la passion amoureuse et l’eros au regard de l’amour de Dieu. D’autre part, il est intéressant de constater que beaucoup de troubadours se sont fait moines à la fin de leur vie. On ne sait pas s’il s’agissait seulement d’un endroit pour se reposer, s’ils cherchaient à expier leur faute, ou si ces chansons d’amour les ont finalement conduits à partir à la recherche du plus grand amour. C’est le chemin que fera Dante, conduit jusqu’à Dieu par sa Divine Comédie avec cette Béatrice qui est presque une figure de l’Église.
De façon générale, au Moyen Âge, il est très difficile de distinguer une littérature profane et une littérature chrétienne. Même des textes qui peuvent apparaître comme provocants sont travaillés par une pensée religieuse et, contrairement à aujourd’hui, aucun auteur ne fait comme si elle n’existait pas. Dans toute la littérature de l’époque, même si l’on ne recherche pas à faire concurrence aux prêtres, on y met toujours une dimension religieuse : on ne perd jamais de vue la figure de Dieu et la question du salut.