Journaliste au Figaro, auteur d’un essai sur le “projet fou des antispécistes”, L’Extinction de l’homme (Tallandier), le normalien Paul Sugy répond aux questions de Aleteia pour éclairer avec nuance la dérive inquiétante à laquelle aboutit les mouvements végans. Réduire l’homme à sa dimension biologique est une chose, mais “anéantir ce qu’il y a d’humain dans l’homme” va beaucoup plus loin.
Aleteia : Comment définissez-vous le projet antispéciste ?
Paul Sugy : L’antispécisme est un courant idéologique rassemblant les militants les plus extrêmes de la “cause animale”. Ceux-ci ne se contentent pas de vouloir améliorer le bien-être des animaux, mais jugent que nos sociétés sont construites sur un fondement discriminatoire, qu’ils appellent “spécisme” : le fait de respecter davantage les intérêts des individus de notre propre espèce que ceux des autres animaux. Pour faire simple, penser qu’un cochon a sa place dans votre assiette, mais pas votre belle-mère, fait de vous un spéciste.
L’antispécisme considère que nos devoirs moraux à l’égard d’un individu ne sont pas déterminés par son espèce mais par ses intérêts.
L’antispécisme considère que nos devoirs moraux à l’égard d’un individu ne sont pas déterminés par son espèce mais par ses intérêts — entendus au sens de ses capacités biologiques. Il remplace le critère de l’espèce par celui de la souffrance, et décrète l’interdiction de faire souffrir volontairement un individu “sentient”, c’est-à-dire capable de souffrir et d’avoir conscience de cette souffrance. Il prône donc une révolution morale et politique, ambitionne d’interdire l’élevage, la chasse et toute autre forme d’exploitation de l’animal par l’homme (jusqu’aux chevaux de trait ou à l’apiculture), et réfléchit d’ores et déjà à l’idée d’octroyer la citoyenneté à nos animaux domestiques.
Et ce n’est pas tout. J’essaie de montrer dans ce livre que l’antispécisme n’est pas un simple changement de regard sur l’animal, mais une réflexion sur l’animalité de l’homme. Les antispécistes disent d’ailleurs “les animaux non-humains”, plutôt que simplement “les animaux”, rappelant par là qu’à leurs yeux les humains sont des animaux… comme les autres. Ils insistent sur ce qui rattache l’homme au règne animal, et tiennent pour accessoire, au plan moral en tout cas, ce qui l’en arrache. Ils réfutent l’idée d’une “nature” humaine, s’en prennent d’ailleurs à l’idée de “nature” en général, et regardent seulement l’homme comme un animal un peu plus évolué qui aurait inventé un système de domination étayé par des arguments religieux ou philosophiques, grâce à son intelligence supérieure. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me reconnais pas dans cette anthropologie-là.
Vous pointez une contradiction dans l’antispécisme qui accorde des devoirs aux hommes et des droits aux animaux. Il y a donc bien pour les antispécistes une “différence spécifique” irréductible entre l’homme et l’animal. Cela signifie-t-il qu’au-delà d’une sensibilité particulière et légitime à la condition animale, il y a d’autres desseins, plus idéologiques ?
Les antispécistes sont bien conscients que le sens moral est presque sans aucun doute une compétence exclusivement humaine, un “propre de l’homme”. Justement, disent-ils, ce sens moral nous oblige, et nous confère des devoirs — en quoi ils n’ont bien entendu pas tort. Ce qui est plus curieux en revanche est qu’ils traduisent nos devoirs à l’égard des animaux en raisonnant, non pas à partir de l’homme et de sa position au sein du vivant, et donc également de sa responsabilité, mais de l’animal lui-même et de son intérêt. On lit sous la plume de Peter Singer (auteur en 1975 de La Libération animale, le premier grand manifeste antispéciste) des réflexions méticuleuses sur les intérêts des animaux, la façon dont ils perçoivent la souffrance. À partir de là, d’autres auteurs antispécistes ont réfléchi à la façon dont nous pourrions proclamer puis garantir des droits aux animaux, réclamant ainsi que le Code civil leur reconnaisse une “personnalité juridique”. On passe ensuite du droit négatif (ne pas être exploité, mangé…) au droit positif : droit de participer à certaines décisions qui les concernent, d’avoir une certaine autonomie dans leur sexualité… C’est toute la réflexion des auteurs de Zoopolis (2011), Sue Donaldson et Will Kymlicka, qui proposent avec une précision surprenante une véritable “théorie des droits des animaux”, explorant jusque dans les moindres détails quelle devra être à l’avenir notre relation à eux. Oubliez déjà le “dressage” : il s’agira désormais de les “éduquer”, afin d’élaborer avec eux des “communautés mixtes” reposant sur des principes de “coopération”, d’”autorégulation” et de “réciprocité”. C’est un peu comme si l’on prenait le scénario d’un film de Disney pour en faire une nouvelle Constitution politique !

L’antispécisme n’est donc pas un simple discours sur la condition animale. Il n’a d’ailleurs pas, heureusement, le monopole de l’action en faveur des animaux. C’est un projet démiurgique qui envisage de refonder l’ensemble de nos relations avec les animaux. Sauf que dans sa hâte de précipiter l’avènement d’une civilisation d’un type nouveau, il feint de ne pas voir qu’en abolissant l’ancienne il anéantit du même coup ce qu’il y a d’humain dans l’homme. Paradoxalement, ce projet insensé surestime la puissance d’agir de l’homme : c’est donc à la fois un décentrement et une hybris — car quoi qu’en pensent les antispécistes, nous n’avons pas et nous n’aurons sans doute jamais le pouvoir d’empêcher la souffrance des bêtes. C’est bien assez que d’essayer déjà de nourrir, de soigner et de protéger nos frères et sœurs en humanité…
Il faut distinguer, dites-vous, la théorie antispéciste et ses applications pratiques qui ne sont pas nécessairement totalisantes, comme le véganisme. Pour autant, vous citez des auteurs qui soutiennent que depuis le XVIIIe siècle, le “végétarisme” est une forme d’antichristianisme. Est-ce en rapport avec une conception de la mort ?
Antispécisme, animalisme, végétarisme, véganisme… On s’y perd parfois un peu ! Il y a deux choses distinctes, les pratiques et les idées. Que des personnes, pour des raisons qui leur sont propres (le souci de leur santé, du climat, du bien-être des animaux…) se refusent à manger de la viande, voilà qui a toujours existé et qui existera toujours. C’est ce que l’on appelle communément le végétarisme, ou même le véganisme lorsque cela va jusqu’au refus de consommer du lait, du miel ou du cuir.
Mais le végétarisme a aussi été depuis l’Antiquité une option philosophique, dont l’antispécisme est la continuation et l’approfondissement. Les penseurs végétariens l’étaient pour diverses raisons là encore, mais ils considéraient que l’exploitation de l’animal par l’homme était injuste et déshonorante. Pythagore chez les Grecs, Porphyre chez les Latins, et beaucoup d’autres avec eux, jugeaient immoral de sacrifier des animaux aux dieux. Au long de l’histoire du christianisme, des hérésies ont tenu la consommation de viande pour immorale, y voyant tantôt une pratique impure, tantôt une preuve de barbarie… Voltaire au XVIIIe siècle se prend d’affection pour les sociétés hindoues, végétariennes, et y voit sans doute une preuve que leurs divinités sont plus clémentes que le Dieu cruel des grands monothéismes.

Ces végétarismes sont à la fois complexes et pluriels, à tel point qu’il est délicat de leur trouver des parentés tant ils procèdent de principes philosophiques ou religieux différents. Mais tout de même, je crois qu’un trait commun entre tous est qu’au fond il s’agit chaque fois d’une remise en cause de la conception chrétienne de la vie humaine. Si l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et qu’il reçoit en héritage la vie dans le Royaume, alors la vie animale n’a rien de commun avec la vie humaine puisqu’elle n’en a pas l’éternité, et donc la dignité. D’ailleurs si Pythagore était végétarien, c’est qu’il croyait dans la métempsychose, la réincarnation des âmes humaines dans des vies animales. Forcément, cela vous passe l’envie de vous faire cuire un steak. J’ai lu une étude qui dans les années quatre-vingt-dix rapportait qu’environ un Français sur quatre croyait dans la réincarnation des âmes… L’antispécisme a beau jeu de se présenter sous les traits du rationalisme (en défendant une morale plus scientifique, voire plus biologique, que celle d’aujourd’hui), je ne m’interdis pas de penser que ses adeptes ne sont pas tous à l’abri de certaines des superstitions à la mode.
Certains auteurs antispécistes radicaux comparent les “animaux non humains” avec les personnes handicapées. Pourquoi cela ne scandalise-t-il pas plus ? Cette pensée qui se veut profondément progressiste n’est-elle pas un antihumanisme ?
Vous faites référence ici à des positions défendues notamment par Peter Singer, et je dois dire par honnêteté intellectuelle qu’elles sont critiquées au sein même de la mouvance antispéciste : disons pour faire simple qu’au vu de la propension de Peter Singer à susciter la polémique à chaque fois qu’il donne une interview, d’autres auteurs se sont empressés de parvenir aux mêmes conclusions que lui mais par des chemins philosophiques différents. Singer en tout cas considérait qu’il serait plus moral dans certains cas de faire des expériences médicales sur des jeunes humains ou des attardés mentaux, que sur des animaux en pleine santé. Sa défense immodérée de l’euthanasie lui a également valu des critiques. Il faut lui reconnaître une certaine cohérence néanmoins : puisque rien ne lui paraît plus insupportable que la souffrance, au point qu’il faille l’éliminer à tout prix, il est aussi logique de vouloir supprimer les abattoirs que de proposer d’euthanasier les personnes en situation de handicap.
L’homme des antispécistes est aussi “sans limite” au sens où plus aucune frontière ne le sépare du reste du vivant.
L’antispécisme est de toute évidence un antihumanisme et il s’assume comme tel. David Olivier ou Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, par exemple, deux essayistes importants de la mouvance antispéciste, n’ont pas de mots assez durs à l’égard de l’humanisme et de ceux qui aujourd’hui encore le défendent — Luc Ferry par exemple, ou Alain Finkielkraut. Ils tiennent l’humanisme pour une construction mentale édifiée afin de fournir à l’homme un prétexte à sa barbarie. Dites-leur que cet humanisme repose (en partie) sur le fondement d’une anthropologie judéo-chrétienne, leur courroux n’en sera que plus sévère. Tout ce qui, dans la pensée de l’homme, démontre ou justifie sa prééminence, n’est à leurs yeux qu’un vaste mensonge auquel nous feindrions de croire par amour de la boucherie.
Philosophiquement, l’anthropologie antispéciste ne vise-t-elle pas simplement à promouvoir un homme sans limite, aussi bien dans sa volonté, sa physiologie que dans son existence ?
Absolument, et c’est en ce sens qu’il s’agit d’une hybris. Dans votre question, il faut entendre “homme sans limite” dans les deux déploiements sémantiques possibles du terme “limite”. L’antispécisme postule en effet que notre considération morale doit sortir de ses ornières étroites et s’étendre désormais à tous les animaux ; il ambitionne pour cela de déployer un gigantesque arsenal de mesures à la fois philosophiques, politiques et juridiques, mais aussi technologiques. L’alimentation végan suppose ainsi une complémentation en vitamines B 12, synthétisées à grande échelle par l’industrie pharmaceutique, faute desquelles l’organisme se retrouve vite carencé. Les antispécistes sont d’ores et déjà en train d’inventer la viande de demain, produite artificiellement dans des pipettes de laboratoire, en faisant se développer in vitro des cellules-souches animales. Si l’on va plus loin encore, certains d’entre eux comme Thomas Lepeltier imaginent que l’on pourrait demain modifier le génome des lions pour leur passer l’envie de manger leurs amies les gazelles… Bref, ni leur imagination ni leur volonté de recourir à la puissance technologique pour assouvir notre soif d’une domination morale absolue sur l’univers ne semblent en effet souffrir de limite.

Mais l’homme des antispécistes est aussi “sans limite” au sens où plus aucune frontière ne le sépare du reste du vivant. C’est un homme au contour trouble et incertain, un homme qui doute de lui-même et sa supériorité sur l’animal, un homme surtout qui renoncerait définitivement à l’idée de séparer les réalités en raisonnant au travers de concepts. Cet homme-là achèverait de se déconstruire, dans son rapport au monde et dans sa perception de lui-même. Ayant déjà renoncé aux frontières entre les nations puis entre les sexes, il abolirait celles entre les espèces, écroulant ainsi l’une des dernières digues qui lui permettaient encore de se croire le dépositaire d’une identité. Dans l’illimitation de ses prétentions, cet homme-là croit s’accomplir en s’effaçant. Il ne fait en réalité que précipiter son extinction.
Propos recueillis par Philippe de Saint-Germain
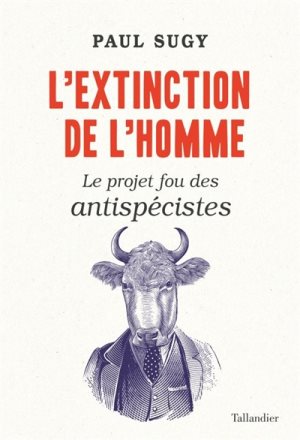
L’Extinction de l’homme, le projet fou des antispécistes, Paul Sugy, Tallandier, mai 2021, 17,9 euros.

